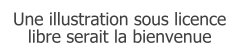Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Sulfurimonas
| Domaine | Bacteria |
|---|---|
| Embranchement | Proteobacteria |
| Classe | Epsilonproteobacteria |
| Ordre | Campylobacterales |
| Famille | Helicobacteraceae |
Espèces de rang inférieur
- Sulfurimonas autotrophica
- Sulfurimonas denitrificans
- Sulfurimonas gotlandica
- Sulfurimonas paralvinellae
- (Sulfurimonas Hongkongensi)
Sulfurimonas est un genre de bactéries de la classe des Epsilonproteobacteria, connu pour réduire les nitrates, oxyder à la fois le soufre et l'hydrogène et contenir des hydrogénases du groupe IV[2],[3],[4]. Ce genre comprend quatre espèces : Sulfurimonas autorophica, Sulfurimonas denitrificans, Sulfurimonas gotlandica et Sulfurimonas paralvinellae. Le nom du genre est dérivé de « soufre » en latin et « monas » du grec, signifiant ensemble une « tige oxydant le soufre »[5]. La taille des bactéries varie environ de 1,5 à 2,5 μm de longueur et 0,5 à 1,0 μm de largeur[6],[7],[4].
Les membres du genre Sulfurimonas se trouvent dans une variété d'environnements différents qui comprennent des évents marins profonds, des sédiments marins et des habitats terrestres[3]. Leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes est attribuée à plusieurs copies d'une enzyme[C'est-à-dire ?][3].
L'analyse phylogénétique suggère que les membres du genre Sulfurimonas ont une capacité de dispersion limitée et que sa spéciation a été affectée par l'isolement géographique plutôt que par la composition hydrothermale[réf. nécessaire]. Les courants océaniques profonds affectent la dispersion de Sulfurimonas spp., influençant sa spéciation[8]. Comme indiqué dans le rapport MLSA[9] des évents hydrothermaux d'eau profonde en 2017, l'Epsilonproteobacteria Sulfurimonas a une capacité de dispersion plus élevée par rapport aux thermophiles d'évents hydrothermaux d'eau profonde, indiquant une spéciation allopatrique[8].
- ↑ (en) F. Inagaki, K. Takai, H. Kobayashi, K. H. Nealson et K. Horikoshi, « Sulfurimonas autotrophica gen. nov., sp. nov., a novel sulfur-oxidizing -proteobacterium isolated from hydrothermal sediments in the Mid-Okinawa Trough », INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, vol. 53, no 6, , p. 1801–1805 (ISSN 1466-5026 et 1466-5034, DOI 10.1099/ijs.0.02682-0, lire en ligne, consulté le ).
- ↑ (en) Zena Cardman, « Active prokaryotic communities along a thermally and geochemically variable transect in Guaymas Basin hydrothermal sediments », ProQuest Dissertations Publishing, .
- (en) Yuchen Han et Mirjam Perner, « The globally widespread genus Sulfurimonas: versatile energy metabolisms and adaptations to redox clines », Frontiers in Microbiology, vol. 6, , p. 989 (PMID 26441918, PMCID 4584964, DOI 10.3389/fmicb.2015.00989).
- (en) Fumio Inagaki, Ken Takai, Hideki Kobayashi et Kenneth H. Nealson, « Sulfurimonas autotrophica gen. nov., sp. nov., a novel sulfur-oxidizing ε-proteobacterium isolated from hydrothermal sediments in the Mid-Okinawa Trough », International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 53, no 6, , p. 1801–1805 (PMID 14657107, DOI 10.1099/ijs.0.02682-0).
- ↑ (en) Johannes Sikorski, Christine Munk, Alla Lapidus et Olivier Duplex Ngatchou Djao, « Complete genome sequence of Sulfurimonas autotrophica type strain (OK10T) », Standards in Genomic Sciences, vol. 3, no 2, , p. 194–202 (ISSN 1944-3277, PMID 21304749, PMCID 3035374, DOI 10.4056/sigs.1173118).
- ↑ (en) Matthias Labrenz, Jana Grote, Kerstin Mammitzsch et Henricus T. S. Boschker, « Sulfurimonas gotlandica sp. nov., a chemoautotrophic and psychrotolerant epsilonproteobacterium isolated from a pelagic redoxcline, and an emended description of the genus Sulfurimonas », International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 63, no 11, , p. 4141–4148 (PMID 23749282, PMCID 3836495, DOI 10.1099/ijs.0.048827-0).
- ↑ (en) Kerstin Mammitzsch, Günter Jost et Klaus Jürgens, « Impact of dissolved inorganic carbon concentrations and pH on growth of the chemolithoautotrophic epsilonproteobacterium Sulfurimonas gotlandica GD1T », MicrobiologyOpen, vol. 3, no 1, , p. 80–88 (ISSN 2045-8827, PMID 24376054, PMCID 3937731, DOI 10.1002/mbo3.153).
- (en) Sayaka Mino, Satoshi Nakagawa, Hiroko Makita et Tomohiro Toki, « Endemicity of the cosmopolitan mesophilic chemolithoautotroph Sulfurimonas at deep-sea hydrothermal vents », The ISME Journal, vol. 11, no 4, , p. 909–919 (PMID 28045457, PMCID 5364360, DOI 10.1038/ismej.2016.178, résumé).
- ↑ La parenté des isolats peut également être analysée avec MultiLocus Sequence Analysis (MLSA) Multilocus sequence typing (en) qui n'utilise pas les allèles attribués, mais concatène à la place les séquences des fragments de gènes des gènes de ménage et utilise cette séquence concaténée pour déterminer les relations phylogénétiques. Contrairement à MLST, cette analyse attribue une similitude plus élevée entre les séquences ne différant que d'un seul nucléotide et une similitude plus faible entre les séquences avec de multiples différences de nucléotides. En conséquence, cette analyse est plus adaptée aux organismes à évolution clonale et moins adaptée aux organismes dans lesquels des événements de recombinaison se produisent très souvent. Il peut également être utilisé pour déterminer les relations phylogénétiques entre des espèces étroitement apparentées. Les termes MLST et MLSA sont très souvent considérés comme interchangeables, ce qui n'est cependant pas correct car chaque méthode d'analyse a ses particularités et ses utilisations.
Previous Page Next Page